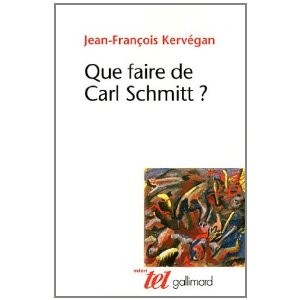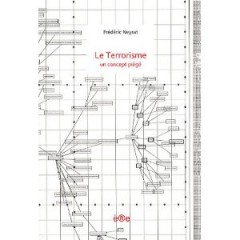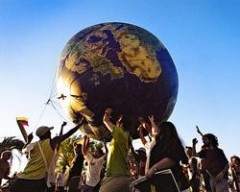De la contestation mondiale bobo-docile et du souverainisme de libération
"Si le mouvement national contemporain ne veut pas se contenter de rééditer les anciennes tragédies amères de notre histoire passée, il doit se montrer capable de s’élever au niveau des exigences de l’heure présente".
James Connolly (1868-1916), fondateur de l’Irish Republican Socialist Party
"Donnez-moi un point d’appui et un levier et je soulèverai la Terre."
Archimède
"Pensez-vous tous ce que vous êtes supposés penser ?"
Tyler Durden
"Ce que nous devons conquérir, la souveraineté du pays, nous devons l’enlever à quelqu’un qui s’appelle le monopole. Le pouvoir révolutionnaire, ou la souveraineté politique, est l’instrument de la conquête économique pour que la souveraineté nationale soit pleinement réalisée".
Ernesto "Che" Guevara
À chaque époque, ses contradictions. L’une des contradictions majeures de notre temps, se déroulant dans la pratique sociale et politique, se présente sous la forme d’une lutte à mort entre les puissances convergeant vers l’homogénéisation planétaire et les mouvements résistant à ce processus. Largement utilisés depuis les années 1980, les termes de mondialisation et de globalisation traduisent l’action des puissances homogénéisantes.
Qu’est-ce que la mondialisation ? L’intégration croissante des économies dans le monde, au moyen des courants d’échanges et des flux financiers. Elle se définit par les transferts internationaux de main-d’oeuvre et de connaissances, et les phénomènes culturels et politiques que ceux-ci engendrent. Les principales caractéristiques en sont : la concentration de la production et du capital sous forme de monopoles ; la fusion du capital bancaire et industriel ; l’exportation massive des capitaux ; la formation d’unions transnationales monopolistes se partageant le monde ; la fin du partage territorial du monde entre les puissances capitalistes.
La mondialisation actuellement en oeuvre est une forme avancée de l’impérialisme capitaliste apparu au début du XXe siècle. Étant donné ses conséquences constatables et prévisibles (mort des cultures, disparition des particularismes, avènement du positivisme néo-kantien bêtifiant, anéantissement de la pensée critique, massification, dressage cognitif, crises économiques et guerres récurrentes, désintégration des religions occidentales et moralisme morbide subséquent, etc.), la mondialisation apparaît, à sa limite, comme un "holocauste mondial", ainsi que l’a définie Jean Baudrillard.
Du côté de la résistance organisée et spectaculaire - les mouvements altermondialistes et antiglobalisation qui défilent dans les médias - règne la confusion la plus grande. L’ambiguïté de la critique qu’ils adressent à la mondialisation et la limite des solutions qu’ils proposent se révèlent patentes si on les passe au tamis d’une critique impartiale. Pétris de bonnes intentions (remarquons à leur actif un notable appel à voter non au référendum sur le Traité européen), les altermondialistes sont aussi, au fond, les meilleurs alliés de la mondialisation capitaliste.
La diversion altermondialiste
D’abord, les altermondialistes sont des gestionnaires, et non des critiques radicaux. José Bové s’en vante : "A Seattle, dit-il, personne ne brandit le drapeau rouge de la révolution chinoise, ni le portrait du Che, ni la victoire révolutionnaire dans un pays devant bouleverser les autres ; c’est bien fini et c’est porteur d’espoir".
Les altermondialistes vitupèrent en effet le capitalisme, mais n’ont en fait nulle intention de le renverser. Ils désirent seulement l’amender. La taxe Tobin, le prélèvement qu’ils veulent instaurer sur les transactions spéculatives, ne s’attaque en réalité qu’à une infime partie de la spéculation et cache le fait que la crise du capitalisme ne porte pas uniquement sur la spéculation mais sur l’ensemble du capitalisme. La crise générale du capitalisme a pour trait distinctif l’accentuation extrême de toutes les contradictions de la société capitaliste. Et ces contradictions sont aujourd’hui portées à un point d’incandescence jamais atteint.
La campagne pour la suppression des paradis fiscaux, autre thème de campagne des altermondialistes, vise quant à elle à moraliser le capitalisme. Mais, à nouveau, la spéculation et les trafics financiers ne sont nullement la cause de la crise. Ils sont seulement la conséquence directe de l’impasse où est acculé le mode de production actuel. Aucune mesure de ce type n’empêchera jamais la crise de se poursuivre ni d’étendre ses ravages.
Au lieu de proposer une alternative efficace, les altermondialistes militent pour un système de redistribution à l’intérieur du capitalisme : les pays riches doivent partager leur richesse avec les pays pauvres, les patrons avec ceux qu’ils exploitent, etc. Ils espèrent ainsi qu’un capitalisme revu et corrigé sera porteur de justice, perpétuant l’utopie d’un capitalisme viable, à orienter dans un sens favorable. Pourtant, il n’y a pas de société "juste" dans le cadre du capitalisme dont l’essence conflictuelle nourrit des antagonismes en cascade. La seule réponse historique valable est de le dépasser, d’abolir le salariat en développant les luttes contre l’exploitation de la force de travail et les rapports capitalistes de production.
Les altermondialistes croient au soft-capitalisme, au capitalisme à visage humain, comme s’ils avaient lu l’oeuvre de Karl Marx avec les lunettes de plage d’Alain Minc. À l’instar de José Bové, avatar actuel de Proudhon, la plupart d’entre eux voudraient retourner au capitalisme de papa, celui des petits producteurs. Leur rêve est de freiner la concentration monopolistique par des institutions internationales qui superviseraient l’économie mondiale. Mais ils oublient que c’est la libre concurrence, constitutive du capitalisme, qui a depuis plus d’un siècle donné naissance aux monopoles mondiaux. C’est la libre concurrence qui a produit le monopole. C’est la libre concurrence du XIXe siècle qui a accouché de la dictature de deux cents multinationales du XXe siècle. Combattre la dictature des multinationales sans combattre en même temps la libre concurrence et le libre marché capitaliste qui les engendrent est un non-sens.
Comme le monopole, la mondialisation est contenue en germe dans le capitalisme : le capitalisme la porte en lui, c’est son produit inéluctable, sa déduction. Les multinationales, les délocalisations, comme les inégalités sociales et la flexibilité, sont les effets naturels de sa logique, le déroulement d’un processus autodynamique irréversible tant que l’on ne se décide pas à le subsumer.
Poussés par le besoin incessant de trouver des débouchés toujours nouveaux, les marchands ont envahi le monde entier. L’exploitation du marché mondial a du coup donné un caractère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Déplorer le cour sur la main "l’horreur économique" comme Viviane Forrester, scander "no logo" comme Noami Klein , hurler "le monde n’est pas une marchandise" ou manifester sous les murailles des forteresses de Big Brother pour que le monde capitaliste reparte du bon pied, ce n’est pas prendre le problème à la racine : c’est le décentrer. Couper les mauvaises herbes sans désherber, c’est leur permettre de repousser.
Le capitalisme est, par nature, une économie poussant à la mondialisation et à la marchandisation. Or tout est marchandisation en puissance, et puisque Dieu est provisoirement mort, il n’y a plus aucune limite humaine connue à l’expansion universelle de la marchandisation si on la laisse suivre son cours. Les marchands ont tout le temps devant eux, et ce ne sont pas les comités d’éthique officiels qui les empêcheront d’agir. Comme ces institutions spectaculaires nourrissent une pensée théologique coupée du terreau social, les marchands ont raison de prendre patience, car la théologie s’écroule toujours un moment donné de l’histoire, lorsque l’infrastructure la rend caduque.
Pour s’opposer concrètement à la marchandisation du monde, il ne suffit donc pas de minauder sur quelques-unes des conséquences annexes du Système, il faut dénoncer celui-ci dans son ensemble et en son fondement. Il importe en premier lieu de commencer par lui donner un nom, car "ce qui est censé être atteint, combattu, contesté et réfuté", comme disait Carl Schmitt, doit être nommé afin de viser la cible en son coeur : ici, il s’agit du mode de production capitaliste. Et il faut également proposer une alternative radicale, car nuancer, c’est considérer que la mécanique mérite de fonctionner, qu’il suffit de l’adapter et d’y incorporer de menus arrangements régulateurs : c’est au fond rester keynésien et marcher main dans la main avec MM. Attali et Fukuyama. "La compréhension de ce monde ne peut se fonder que sur la contestation, et cette contestation n’a de vérité qu’en tant que contestation de la totalité", écrivait Guy Debord.
Au temps où on évoquait (déjà) les États-Unis d’Europe, un révolutionnaire célèbre avait (déjà) remarqué que les gauchistes - ancêtres des altermondialistes - étaient les meilleurs alliés des opportunistes. Les gauchistes partagent en effet la vision de ceux qui veulent perpétuer le Système à la solde duquel ils vivent. Si l’ex-animateur du Mouvement du 22-Mars, Daniel Cohn-Bendit est devenu le meilleur allié de l’ancien cofondateur du mouvement atlantiste Occident, Alain Madelin, formant ainsi le noyau du libéral-libertarisme, ce n’est pas à cause d’une conjonction astrale fortuite : c’est parce que leurs destins convergents étaient inscrits dès l’origine dans leurs gènes idéologiques. Nous revivons cycliquement cette situation, aujourd’hui avec les altermondialistes, qui ne sont en somme que des antimondialistes de papier.
Les altermondialistes au service de l’oppression
Face la mondialisation du capital, on assiste à une mondialisation des résistances et des luttes. Seulement il ne s’agit pas de courants authentiquement antimondialistes - telle était leur dénomination première, et le changement de terminologie, opéré à leur instigation, est lumineux -, car ils militent de facto pour une "autre mondialisation", comme l’assure et l’assume François Houtart, directeur la revue Alternatives Sud. Susan George, présidente de l’Observatoire de la mondialisation se détermine, elle, en faveur d’une "mondialisation coopérative". Les chefs de file de l’altermondialisme médiatique se veulent ainsi des mondialistes. L’un des livres de Bové s’intitule Paysan du monde. Les altermondialistes revendiquent simplement l’avènement d’un mondialisme plus humain.
Du coup, et ce n’est pas un hasard, les voici réclamant l’avènement de la mondialisation des Droits de l’homme. Lorsque José Bové se rend Cuba, la première pensée qui lui traverse l’esprit, c’est qu’il y a "beaucoup de policiers dans les rues" et "des queues devant les magasins". Ce distrait vient d’oublier les quarante années d’embargo américain. Il aurait pu dire : "La mortalité due à la maternité est dix-sept fois plus basse à Cuba que la moyenne mondiale". Mais il est passé à côté, car il raisonne en métaphysicien, articulant des catégories fixes d’usage obligatoire dans un Système que de telles notions ont pour unique mission de soutenir. Il n’a pas compris que les Droits de l’homme sont devenus l’idéologie par laquelle les pays riches s’ingèrent dans les affaires des pays pauvres (hochet kouchnerien à vocation exterministe, depuis le Vietnam jusqu’à l’Irak, en attendant mieux). Et qu’au final, les Droits de l’homme sont devenus le cheval de Troie des oppresseurs d’aujourd’hui.
Comme l’a démontré Noam Chomsky, c’est en se fondant sur ces principes universels datant de la révolution bourgeoise que les États-Unis ont déclaré toutes leurs guerres depuis cinquante ans. Preuve éclatante de leur manque de logique, MM. Bové et ses amis ne se sont pas demandé qui ferait régner ces Droits précieux sur le monde, ni quelle puissance idéalement autonome parviendrait à lutter contre les diverses influences économiques et politiques pour les appliquer avec impartialité. Ni par qui serait élue cette autorité mondiale suprême. Ni comment elle gouvernerait. Ni quel parti ou quelle tendance de parti la dirigerait. Ni avec quelles forces armées elle se ferait respecter.
La tendance despotique de ce Léviathan serait, de plus, consubstantielle à son existence, puisque l’expérience a prouvé que plus un organisme est éloigné des individus qu’il encadre, plus son déficit démocratique est levé. On peut donc s’étonner que des anarchistes et des gauchistes soutiennent l’édification d’un tel monument d’oppression.
L’utopie des altermondialistes est donc totale. Ils croient en la vertu opératoire de la parole magique : "Monde, ouvre-toi !" , et le trésor des 40 voleurs nous sera acquis. Or le monde est un rapport de forces entre puissances économiques, et il ne suffit pas de vouloir avec détermination, ni de crier à tue-tête que les États-Unis, fer de lance de l’impérialisme, réduisent leur puissance pour que celle-ci décline dans les faits. Croire le contraire relève de la naïveté. Être naïf, c’est se payer le luxe d’être inopérant. Et tout mouvement inopérant encourage nolens volens la persistance du système qu’il prétend combattre.
La nation comme foyer de guérilla
De glissement en compromis, d’accommodement en complicité objective, les altermondialistes reprennent ainsi dans leurs discours les arguments qui soutiennent le plus puissamment les intérêts des capitalistes. C’est-à-dire qu’ils s’inoculent à haute dose - et inoculent à ceux qui les écoutent - le virus qui justifie l’oppression, en retour.
Le mépris qu’ils affichent pour le fait national, auquel ils substituent un antiracisme formel, sentimental et terroriste, est à ce titre révélateur. Si les peuples désorientés par l’évolution actuelle et le dynamitage des frontières se jettent parfois dans les bras de partis qui semblent ici et là leur proposer un barrage provisoire au mondialisme, ce n’est pas, comme le prétendent les belles âmes de l’altermondialisme, parce qu’ils sombrent dans le fascisme, notion datée et dépassée. C’est d’abord parce que ces populations vivent au quotidien des situations dramatiques et déchirantes, et que nul ne leur propose un avenir digne d’être vécu, les altermondialistes moins que les autres, avec leur programme gauchiste de tabula rasa. C’est sur cette base qu’il faut édifier une réflexion.
A contrario, il est bien sûr parfaitement ridicule de prôner le raidissement identitaire comme solution-miracle. "Le repli sur la tradition, frelaté d’humilité et de présomption, n’est capable de rien par lui-même, sinon de fuite et d’aveuglement devant l’instant historial" écrivait Martin Heidegger. Le désir de rejouer le passé est vain, car "l’histoire ne repasse pas les plats", ainsi que le disait plaisamment Céline. Tout autre est l’affirmation d’une communauté nationale populaire vivante, une communauté de culture et de destin qui entend conserver son indépendance, sa volonté de puissance, sa capacité d’agir sur son avenir en puisant dans un héritage partagé, et qui offrirait la possibilité d’un contrôle populaire réel et conscient sur le pouvoir et l’expression libre des aspirations et des besoins.
La nation, catégorie historique du capitalisme ascendant, demeure en effet, contre de nombreuses prévisions, une réalité à l’époque du capitalisme déclinant. Elle devient même, selon la conception de Fidel Castro, un "bastion", un pôle de résistance révolutionnaire. La défense d’une communauté attaquée dans sa substance s’avère d’autant plus révolutionnaire que l’agression provient d’un système coupeur de têtes et aliénant. Le world-capitalisme a en effet intérêt à trouver devant lui des peuples désagrégés, des traditions mortes, des hommes fébriles et sans attache, disposés à engloutir son évangile standardisé. Ce qui freine la consommation de ses produits mondiaux, ce qui est susceptible de ralentir l’expansion de ses chansons mondiales formatées, de ses films mondiaux compactés, de sa littérature mondiale normalisée, doit disparaître, ou finir digéré dans ses circuits, ce qui revient au même. Le capitalisme est uniformisateur et l’arasement préalable des esprits encourage son entreprise uniformisatrice. Il ravage l’original, les particularismes, sauf ceux qui vont momentanément dans le sens qui lui profite.
Or la communauté, aspiration profonde des hommes, voit dans la forme nationale son actualité la plus aboutie. Passant pour les altermondialistes comme un résidu passéiste, une province pourrissante, un paradoxe historique au temps du cosmopolitisme triomphant, la nation conserve sa justification historique, a minima par le "plébiscite de tous les jours" qu’évoque Ernest Renan. Le patriotisme est un des sentiments les plus profonds, consacré par des siècles et des millénaires. Aujourd’hui, la nation conserve donc un contenu réel, qui, même s’il est épars et dilapidé, est à retrouver et à se réapproprier : "Délivré du fétichisme et des rites formels, le sentiment national n’est-il pas l’amour d’un sol imprégné de présence humaine, l’amour d’une unité spirituelle lentement élaborée par les travaux et les loisirs, les coutumes et la vie quotidienne d’un peuple entier ? ", disait Henri Lefebvre. L’étude du contenu national doit être au cour du programme d’un projet de renaissance.
Évidemment, la démocratie formelle n’a réalisé jusqu’ici qu’une pseudo-communauté abstraite qui frustre la plus grande partie du peuple, à commencer par les couches populaires (classe ouvrière et classes moyennes) sur qui pèse le fardeau le plus lourd. Car le Parlement, fût-il le plus démocratique, là où la propriété des capitalistes et leur pouvoir sont maintenus, reste une machine à réprimer la majorité par une minorité ; la liberté y est d’abord celle de soudoyer l’opinion publique, de faire pression sur elle avec toute la force de la money. La nation telle qu’elle doit être envisagée dans le cadre d’une pensée radicale ne peut qu’aller de pair avec le progrès social et l’alliance internationale avec les forces qui partagent cette ambition subversive totale. L’identité nationale doit être conçue comme une réorganisation sociale sur la base d’une forme élaborée de propriété commune, sous peine de nous ramener à un passé désuet, qui nous conduirait immanquablement au point où nous en sommes.
La nation doit être le cadre de l’émancipation, de l’épanouissement, et non une entité oppressive. C’est seulement comme instrument du progrès qu’elle conserve sa mission historique. Conception qui faisait dire à Lénine : "Nous sommes partisans de la défense de la patrie depuis le 25 octobre 1917 (prise du pouvoir par les bolcheviks en Russie). C’est précisément pour renforcer la liaison avec le socialisme international, qu’il est de notre devoir de défendre la patrie socialiste."
La souveraineté nationale - non pas le souverainisme libéral ou le national-libéralisme, des oxymores dont il faut apprendre à se dépolluer - constitue ainsi, dans le meilleur des cas (exemple frappant du Venezuela bolivarien de Hugo Chávez), un pôle vivant de résistance à l’homogénéisation, une structure servant d’appui à la contestation globale, un foyer possible de guérilla au sens guévarien du terme. Si elle s’intègre dans une lutte émancipatrice au plan national (engagement dans un processus anticapitaliste) et international (retournement des alliances, nouvelle forme d’internationalisme rationnel, et non abstrait ou mystique, c’est-à-dire avec des allés objectifs et partisans), elle ne peut plus être considérée comme un vulgaire sédatif aux luttes sociales, comme elle le fut un temps (le nationalisme bourgeois désunissant les ouvriers pour les placer sous la houlette de la bourgeoisie). Elle devient au contraire l’avant-garde de la radicalité. Sans l’autonomie et l’unité rendues à chaque nation, l’union internationale des résistants au Système (une fraternité, une collaboration et des alliances nouvelles qui ne sont pas à confondre avec la mélasse mondialiste) ne saurait d’ailleurs s’accomplir. C’est lorsqu’un peuple est bien national qu’il peut être le mieux international.
La nation ainsi comprise est tout l’inverse des duperies formalistes à fuir à tout prix : niaiserie sentimentale, chauvinisme étriqué version Coupe du monde, cocardisme sarkozyste à choix multiple, roublardise mystificatrice d’un Déroulède germanopratin digéreant mal l’oeuvre de Charles Péguy, crispation irraisonnée sur les mythes fondateurs, etc. Elle devient l’une des pièces agissantes du renversement du Système. Dans des conditions historiques différentes, Sultan Galiev pour les musulmans, Li Da-zhao pour les Chinois ont en leur temps théorisé une notion approchante, considérant que le peuple musulman, d’un côté, chinois de l’autre, pouvaient, par déplacement dialectique provisoire, être dans leur ensemble considérés comme une classe opprimée en prise avec le Système à renverser. Chaque nation entrant en résistance frontale, pour autant qu’elle s’identifie avec l’émancipation générale, devient ainsi de nouveau historiquement justifiée. On a peut-être une chance de voir alors se produire l’encerclement des villes de l’Empire par les campagnes, les bases arrières et les focos.
Pour un nouveau différentialisme et un souverainisme de libération
Les particularités culturelles, les richesses nationales, individuelles et naturelles sont des armes que le mot d’ordre de world-culture, claironné par les altermondialistes-mondialistes, lors de leurs rassemblements champêtres, désamorce. Plus que quiconque, les artistes - parlons-en - devraient se préoccuper de marquer leurs différences, d’imposer des styles nouveaux et des concepts baroques, d’instiller des idées réactives, de dynamiter les formes étroites dans lesquelles on veut les faire entrer. Eux les premiers devraient se méfier d’instinct de la gadoue musicale qu’on leur propose comme horizon indépassable. Eux les premiers devraient imposer de nouvelles formes poétiques et un style adapté à la lutte contre l’homogénéisation totalitaire qui tend à les émasculer. Leur ouvre est écrasée sous les impératifs de production. La créativité a disparu devant la productivité. Qu’ils se donnent enfin les moyens d’être eux-mêmes : "Que chacun découvre pour la prendre en charge, en usant de ses moyens (la langue, les ouvres, le style) sa différence, écrivait encore Henri Lefebvre, au temps de son Manifeste différentialiste, ajoutant : "Qu’il la situe et l’accentue". Car exister, c’est agir. Et créer.
Dans d’autres domaines, il s’agirait également de repenser la modélisation de la dialectique, le renversement des tabous historiques et idéologiques, la défétichisation des concepts usés jusqu’à la corne par des philosophes ordonnés au Système (ou, pour certains l’ordonnant), de remettre en chantier une théorie de la subjectivité qui ne soit pas subjectiviste, etc. Un laboratoire d’élaboration conceptuelle serait le bienvenu (appelons-le Projet Archimède, du nom du grand scientifique grec de Sicile qui cherchait un point d’appui et un levier pour soulever le monde), sorte de fight-club de la théorie qui se donnerait comme objectif la critique impitoyable de l’existant dans sa totalité. Il faut retrouver l’idée de mouvement, en lui incluant bien sûr une logique de la stabilité qui sied à toute défense identitaire.
Face aux hyperpuissances d’homogénéisation, il est grand temps que l’antimondialisation réelle et efficace présente un front uni et international des différences, un bloc historique constitué par une armada pirate se lançant à l’abordage des vaisseaux de l’Empire.
Avant de réclamer une autre forme de mondialisation, une mondialisation toujours plus ouverte, c’est-à-dire de poursuivre, sur un mode de contestation bobo-docile, la mondialisation capitaliste par d’autres moyens en bradant dès aujourd’hui le monde aux multinationales comme si elles étaient au service de l’Internationale prolétarienne, les mouvements d’altermondialisation-mondialistes-contre-le-capitalisme-sauf-s’il-est-humain doivent prendre conscience que chaque peuple, chaque langue, chaque ethnie, chaque individu, chaque particularité est un reflet de l’universel, un éclat d’humanité. Pour l’avoir oublié, nous sommes entrés dans la norme de la société du "on", où se déploie le Règne de la Quantité annoncé par René Guénon, un monde de grisaille suant la "nullité politique" décrite par Hegel, qui n’est plus régulé que par la seule loi de la valeur capitaliste, l’habitude, l’hébétude et la résignation. Il est temps d’y remettre de la couleur et du mouvement, et, ce faisant, trouver les formes possibles du dépassement de la contradiction actuelle et aider à la prise de conscience de la dialectique de l’histoire présente.
Cette invitation aux particularités ne doit pas se faire de manière parodique ni mimétique, comme nous y invite le Système, mais en Vérité, comme parle l’Évangile, la vérité "révolutionnaire" de Gramsci et celle qui "rend libre" de saint Jean. C’est-à-dire comme un moment essentiel d’un projet de révolution maximale, ayant pour objectif d’inventer un nouveau style de vie. "Tout simplement, je veux une nouvelle civilisation", disait Ezra Pound. C’est bien le moins auquel nous puissions prétendre.
Ce n’est qu’en procédant par étapes que l’on pourra intensifier infiniment la différenciation de l’humanité dans le sens de l’enrichissement et de la diversification de la vie spirituelle, des courants, des aspirations et des nuances idéologiques. Dès à présent, l’internationalisme véritable, au lieu d’être l’idiot utile du capitalisme, doit s’opposer à toutes les tentatives d’homogénéisation mondiale et tendre à défendre sur le mode symphonique les particularismes nationaux, en tant qu’ils peuvent se constituer en fractions d’un souverainisme de libération, mais aussi les particularismes régionaux et individuels. Tel doit être le véritable projet des adversaires du mondialisme. Le reste n’est que bavardage, compromission et désertion en rase campagne.
Que cent fleurs s’épanouissent !
Paul-Éric Blanrue, mai 2008.